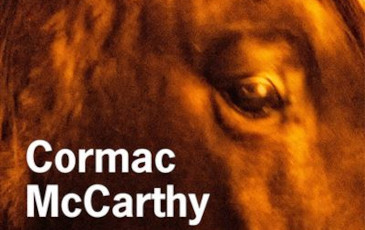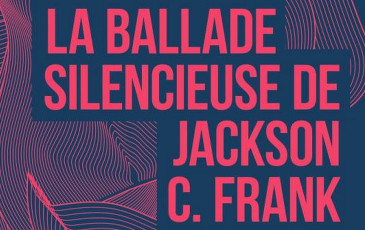Faut-il pilonner un manga parce qu’il a presque vingt ans, que son papier a jauni et qu’on manque de place ?
Nombre de bibliothécaires ne se posent même plus la question, selon la maxime qui veut qu’un livre chasse l’autre et que le lecteur cherche avant tout du neuf. Mais pourquoi se priver de Tengu ? Pourquoi se priver d’une série qui, sans prétendre être un classique, occupe une place non négligeable dans l’œuvre du dessinateur de Stratège et de Tsuru, princesse des mers ?
Dessinateur au réalisme puissant, Hideki Mori s’est fait une spécialité du jidaimono, le drame historique relatant les prouesses des rônins et autres guerriers du bon vieux temps où l’on pouvait encore trancher dans le vif sans encourir trop d’embêtements. Adapté d’une série de romans très populaires de Jirô Osaragi (1897-1973), le Tengu du mont Kurama est une sorte de Zorro ou de Robin des bois sauce miso, un samouraï sans maître faisant régner la justice dans la période troublée qui vit la fin du shogunat et la restauration de l’empereur Meiji. On aurait tort, cependant, de n’y voir qu’un divertissement sans enjeux, tant le genre se veut souvent porteur d’un discours politique (une série comme Kamui Den, par exemple, très ancrée à gauche, a profondément marqué la société japonaise). À la façon d’un Michel Zévaco pour le roman de cape et d’épée, Osaragi assume lui aussi un propos non dénué d’idéologie : partisan de l’empereur, le Tengu se bat avant tout pour un monde plus juste, où chacun ait sa chance. « Ce que je veux savoir, c’est si on entendra des rires d’enfants, dans ce pays que tu me promets », demande-t-il à un reître recherchant son alliance. Aussi le récit tout entier est-il centré non pas tant sur lui que sur le jeune Sugisaku, petit acrobate des rues tiraillé entre son amour pour le justicier et l’indéfectible sympathie d’un capitaine du Shinsengumi, la très redoutée milice shogunale chargée de faire régner l’ordre à Kyoto. Car l’avenir du pays, c’est lui, l’enfant du peuple, au moment où les Occidentaux, forçant le Japon à sortir de son isolement, lui imposent des traités aux conditions outrageusement inégales, déstabilisent son économie et bousculent sans vergogne une société profondément conservatrice pour la faire entrer aux forceps dans la modernité. Quel pays le Japon veut-il pour ses enfants ? Tengu ne pose pas d’autre question, qui prend précisément place à ce carrefour de l’histoire du Japon que fut, de 1868 à 1869, cet épisode de guerre civile. Mais un carrefour en appelle un autre et c’est, en filigrane, la même question, très actuelle, que posait Osaragi dans la confusion de l’après-guerre, alors que des choix nouveaux s’imposaient à la société.
Pour le lecteur occidental, c’est donc une véritable leçon d’Histoire où pointe à chaque coin de case, sans manichéisme et dans toute sa complexité, une réalité qu’il ignorait. On en ressort un peu moins bête, un peu plus conscient des conséquences de nos actes « civilisateurs » et prêts à enquiller sur le très sérieux Au temps de Botchan, de Natsuo Sekikawa et Jirô Taniguchi, que nul, espérons-le, ne songerait à pilonner.
Alors ? À la poubelle, le Tengu ?
Yann Fastier