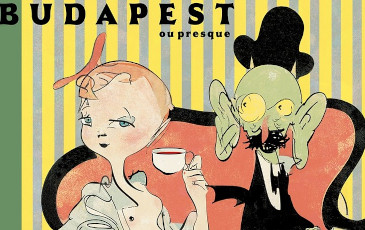Pour qui se souvient des lointaines années 90, Adrian Tomine n’est pas un inconnu.
Son « comix » Optic nerve fut même l’un des marqueurs de la BD américaine de ces années-là, accompagnant le profond mouvement de renouveau de la bande dessinée « indépendante » aux côtés d’un Daniel Clowes, d’un Chris Ware (grand prix 2021 de la ville d’Angoulême) ou du trio de mousquetaires Seth, Chester Brown & Joe Matt. Si quelques-uns de ceux-là ont mal vieilli ou carrément disparu (Julie Doucet, passée du côté de l’art, Joe Matt ou Chester Brown, englués dans leurs problèmes sexuels…), ce n’est pas le cas d’Adrian Tomine, dont on peut même dire qu’il se bonifie avec le temps. Ça n’était pourtant pas gagné d’avance tant, avec le recul, ses histoires de l’époque apparaissent vaines et guindées, aussi raides qu’un dessin qui, pour marcher ostensiblement sur les traces de Dan Clowes et des frères Hernandez, ne fit jamais de miracles (comme en témoigne le très dispensable Scrapbook, paru en 2004 chez Drawn & Quaterly). De fait, c’est à bon droit qu’on aura cru le « petit prodige des mini-comics » perdu pour la cause quand il aura fallu attendre presque dix ans et la parution des Intrus (Cornélius, 2015) pour le voir revenir en pleine forme, son style renouvelé, arrondi et mûri en profondeur. Aujourd’hui, loin de l’arrogance toute juvénile et « littéraire » d’Optic Nerve, La solitude du marathonien de la bande dessinée fait un retour plein d’humilité et d’auto-dérision sur ce parcours qui n’est, au fond, que celui de tout auteur qui se respecte, avec son lot de solitude, de doutes et de petites humiliations. Qui a jamais commis le moindre petit ouvrage reconnaîtra ce sentiment d’imposture qui ne vous quitte jamais, dit-on, même après l’obtention du Nobel, cette difficulté, tout simplement, à se situer face aux autres et dans la société. Ce que les auteurs revendiquent de plus en plus fort comme un métier comme les autres reste, quoi qu’on en dise, une activité socialement floue, archi-dépendante d’une reconnaissance toujours aléatoire et, surtout, très relative. La blessure narcissique n’est jamais loin et si Adrian Tomine préfère en rire aujourd’hui, on ne peut s’empêcher de compatir, pour avoir soi-même connu des situations de ce genre : longues stations dans des librairies vides où l’on finit par dédicacer un livre au libraire, salons du livre où tout le monde dédicace à tour de bras, sauf vous, rencontres publiques où de brillants agresseurs vous somment de vous expliquer sur tel ou tel aspect embarrassant de votre travail, etc. Tout y est, tout est vécu et rien n’aura été décidément épargné à l’auteur, jusqu’à devoir s’entendre démolir un soir par un quidam au hasard d’une table de cafeteria !
Au fond, quel meilleur remède à la grosse tête ? Avec ce petit livre et en attendant quelque récit plus ambitieux, Adrian Tomine prouve au moins qu’il l’a plutôt solide, bien faite et, en tout cas, encore sur les épaules.
Yann Fastier