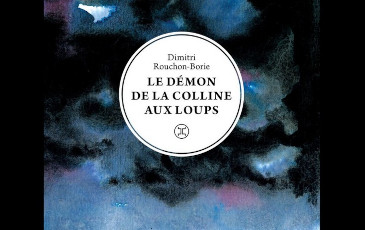En proie à une sévère dépression post-partum, une jeune femme est tenue à l’isolement par son médecin de mari,
persuadé que seul le repos absolu, dans une vaste et vieille demeure à la campagne, pourra l’en guérir. Dévastée par l’inactivité et l’ennui, celle qui n’aime rien tant qu’écrire est bientôt fascinée par un motif du papier peint de sa chambre, au point d’en devenir folle.
Ce n’est qu’une courte nouvelle mais elle est de celles qui ne s’oublient pas facilement. D’abord parce qu’elle est parfaitement horrifiante – dans un registre voisin du Horla de Maupassant ou du Tour d’écrou de James – ensuite parce qu’elle est susceptible de multiples lectures, au regard de la biographie de son autrice comme de la condition faite aux femmes de son temps, dont elle fut une infatigable pourfendeuse. À ce double égard, la longue postface de Diane de Margerie s’avère précieuse, qui nous présente Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) comme le type de l’écrivaine constamment empêchée – par sa mère, par la fortune (au contraire d’une Edith Wharton à laquelle on l’associe parfois), par la maladie et, d’une façon générale, par le poids d’une société qui cantonne encore largement la femme à l’espace domestique et à la maternité. Elle-même victime d’une semblable cure de repos imposée par un neurologue imaginatif, elle écrit donc comme on se venge, avec une rage qui dépasse cependant son cas personnel et se fait militante. Prenant la seule issue possible à sa souffrance, la jeune séquestrée finit par littéralement passer sur le corps sans vie de son époux trop bien intentionné, choisissant de ramper puisque empêchée d’écrire quand, elle en est malgré tout bien consciente, « (…) d’habitude, les femmes ne rampent jamais à la lumière du jour ». Figure complexe et parfois contradictoire d’un féminisme en devenir, Charlotte Perkins Gilman, quant à elle, ne s’en priva jamais.
Yann Fastier