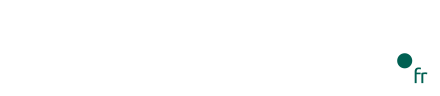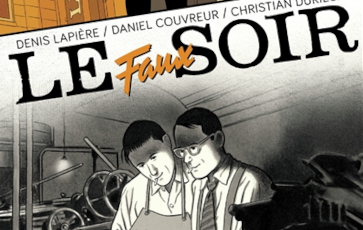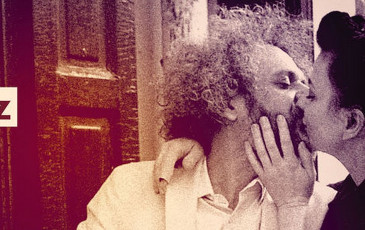Qu’on le veuille ou non, le shōjo manga reste un peu le parent pauvre de la bande dessinée japonaise, en tout cas sous nos latitudes.
Réputé « affaire de filles », il ne serait que grands yeux humides et roucoulades sentimentales agrémentées de fleurs en cascades, mélodrames à l’eau de rose pour collégiennes en émoi, historiettes peuplées d’éphèbes évanescents inéligibles au Fight Club… quoi qu’il en soit quantité négligeable au regard du shōnen, qui règne encore sans partage sur les gonades en approche de nos futurs couillons. C’est un tort. Car le shōjo fut et reste à bien des égards plus audacieux et innovant que les concours de baston entrecoupés de gaudriole auxquels se résume bien souvent son faux jumeau. Mise en page audacieuse héritée de l’Art nouveau, maturité des récits, qui s’ouvrent à des thèmes parfois difficiles ou franchement tabous dans une société encore pesamment patriarcale, le shōjo est loin, bien loin de faire figure de second couteau. Paris ni Tokyo ne s’étant cependant pas faits en un jour, il aura fallu bien des pionnières pour que le genre atteigne enfin son âge d’or dans les années 70, sous l’impulsion des fameuses « Fleurs de l’an 24 » parmi lesquelles Moto Hagio eut une place éminente. Aux côtés de Ryoko Ikeda et de sa fameuse Rose de Versailles, Moto Hagio fut avec Le Clan des Poe et Le cœur de Thomas – inspiré, cocorico, des Amitiés particulières de Roger Peyrefitte – à la tête d’une œuvre dont on n’a pas fini de mesurer l’influence auprès des générations suivantes. Elle fut surtout l’une des premières autrices à proposer des récits de science-fiction, son genre de prédilection, dont ce volume reprend l’un des plus fameux : Nous étions onze !, huis-clos haletant où dix candidats à l’Université spatiale, enfermés dans un vaisseau en perdition, doivent découvrir avant la catastrophe finale quel est l’intrus qui s’est introduit parmi eux. Peuplée de personnages attachants, dont un « iel » avant la lettre, cette histoire et sa suite immédiate (Est et Ouest, un horizon lointain) sont restées des classiques d’un genre où la dessinatrice ne cessera de s’illustrer, de Star Red à Marginal ou Barbara. Aussi est-il un peu frustrant de la part de l’éditeur de ne pas leur avoir réservé toute la place qui leur revient dans un volume spécialement dédié au lieu de les enfermer entre deux courtes histoires de fantômes dans une anthologie par ailleurs assez curieusement mal nommée.
Yann Fastier