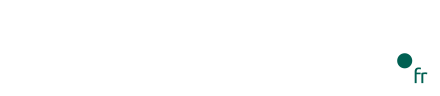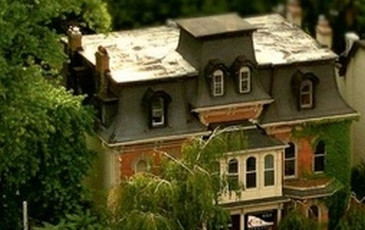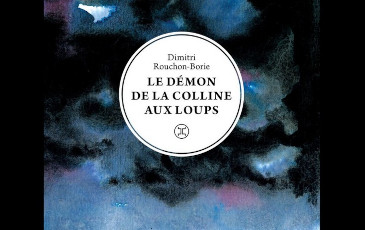Malévitch et Kandinsky n’avaient rien inventé : deux ou trois siècles avant l’irruption de la peinture abstraite, des artisans du Rajasthan produisaient déjà des « peintures sans images » comme support à la méditation des adeptes locaux du tantrisme.
Ici, un carré à bandes régulières rappelle Daniel Buren ; là, un triangle noir associé à un cercle rouge évoque El Lissitsky et les Suprématistes russes ; on songe ailleurs aux minimalistes américains… De petit format, réalisés à la peinture à l’eau sur de vieux papiers souvent rafistolés, ces tableaux surprenants de fraîcheur et d’harmonie ne relèvent pourtant pas des beaux-arts et n’ont de valeur marchande que celle que les Occidentaux veulent bien leur prêter. Car il ne s’agit pas tant de produire de la beauté que de synthétiser une vision, de fixer l’attention du méditant sur un symbole dont il a préalablement appris à connaître le sens. Souvent caricaturé en Occident comme une sorte de « yoga sexuel », le tantrisme est en vérité une branche fort vénérable de l’hindouisme, riche en rituels de toute sorte, y compris la récitation à l’infini de mantras et la méditation, à laquelle ces graphismes colorés viennent donner corps et sens. La feuille, épinglée devant le disciple, n’a d’autre fonction que d’orienter son attention vers un thème donné dont la peinture n’est que la traduction graphique. Autant dire qu’on est loin du culte bruyant de la dévotion populaire. Plus près, au contraire, d’un certain ésotérisme exigeant, non pas le secret, mais une discrétion qui, pour le poète et collectionneur Franck André Jamme (1947-2020), ne fut pas le moindre des obstacles dans la quête obstinée de ces peintures. Pour ceux d’entre nous qui sont trop jeunes pour avoir vu la fameuse exposition des « Magiciens de la terre » (Centre Pompidou, 1989), où le grand public les découvrit pour la première fois, ce livre doucement sidérant vient combler une lacune et rappeler que l’Occident, en matière d’art comme dans bien d’autres domaines, n’est guère qu’un arrogant blanc-bec né de la dernière mousson.
Yann Fastier