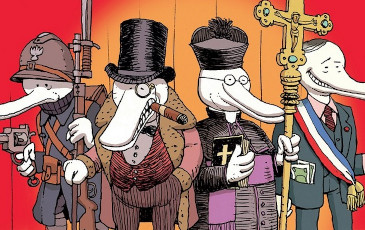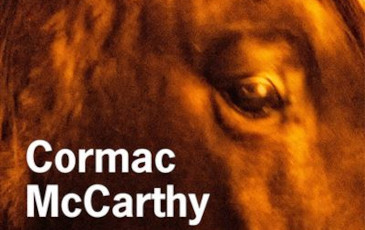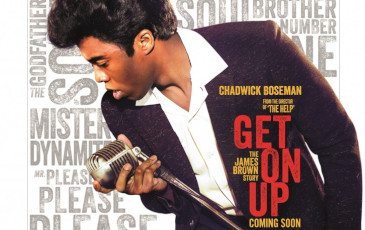Qui sera le nouveau Dyckgraef – littéralement le « Comte des digues » – après la mort de M. Briat ?
Qui veillera sur les polders, les digues, les écluses et les schorres de cette région de l’Escaut dont le vieil homme passionné avait officiellement la charge depuis de nombreuses années ? Qui, sinon sa fille, naturellement, la jeune Suzanne à laquelle il a tout appris, quand personne n’aime autant qu’elle « se promener » le long du grand fleuve, attentive au moindre signe, experte à repérer la moindre faiblesse et à commander les travaux nécessaires ? De l’avis de tous, à commencer par sa tante, ce n’est pourtant pas là le rôle d’une jeune fille, célibataire qui plus est : le rôle d’une jeune fille est de se marier, bourgeoisement si possible et surtout pas, comme l’insinue la rumeur, avec le beau Triphon, régisseur de son père, capable et travailleur mais néanmoins domestique et « mangeant à la cuisine ». « Zelle Zanne » sait-elle elle-même ce qu’elle veut ? Rien n’est moins sûr, surtout depuis qu’elle a fait la connaissance de l’excentrique et bohème M. Larix, qui se borne pourtant à agir avec elle en bon camarade, sympathique et plein de tact. De cette trame un peu lâche on aurait pu craindre voir sourdre un banal roman sentimental : c’est au contraire un grand roman qui débaroule, avec toute l’ample majesté d’un fleuve en crue. Car le seul, le véritable amant de Suzanne, c’est au fond l’Escaut, ce « pays de Verhaeren », cette région « plane, savoureuse, soumise et maniable » où « toutes les choses étaient au service des hommes » dont Marie Gevers excelle à peindre les couleurs mouvantes et la moindre nuance, le plus léger changement au gré des quatre saisons de son premier roman.
Paru en 1931, La comtesse des digues constituait en effet le coup d’essai tardif de Marie Gevers (1883-1975), qui n’était alors qu’une ancienne protégée du grand Émile Verhaeren avant de devenir l’une des figures les mieux aimées des lettres belges. Née et élevée au domaine de Missembourg, près d’Anvers, Marie Gevers est représentative de ces élites flamandes alors parfaitement bilingues, éduquées en français mais réservant toute leur tendresse au flamand maternel, essentiellement dévolu à la vie courante. Il en résulte une souplesse, une agilité dans la langue qui, faisant fi de toute vaine virtuosité, procure à qui la lit un sentiment de bonheur assez inexplicable, sauf à partager les sentiments élégiaques d’une autrice qui mit semble-t-il beaucoup d’elle-même dans sa jeune héroïne, élevée comme elle au milieu d’un jardin dont elle devait se contenter d’abattre les murs pour l’étendre aux dimensions d’un pays. Petit pays, dont le nom de Marie Gevers n’a guère franchi la frontière, elle qui fut pourtant à la Flandre ce que Stéphanie Corinna Bille fut au Valais suisse, couturière aux doigts de fée dont la phrase aura su relier pour toujours un terroir à l’immensité du ciel.
Yann Fastier