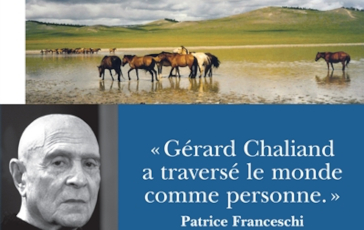Avant de tourner en France des films légers, tendres, fantasques, poétiques, Otar Iosseliani tournait des films légers, tendres, fantasques, poétiques en Géorgie.
Des films que personne ou presque ne put voir à l’époque, une censure tatillonne veillant au grain, quand bien même elle n’en trouvait guère à moudre dans des œuvres dont la seule singularité suffisait cependant à lui mettre la puce à l’oreille. Difficile, en effet, de comprendre ce qui motiva l’interdiction de ces films sinon leur seule originalité qui, aux yeux des censeurs, devaient contenir les ferments d’une liberté dont, dans le doute, mieux valait contenir les divagations. Elle fit si bien, entre interdictions pures et simples et limitations de diffusion, qu’elle devait pousser le cinéaste à s’exiler en France où, à 86 ans, il poursuit une œuvre discrète et profondément personnelle, inclassable, sinon peut-être – en le disant vite – du côté d’un Jacques Tati.
Aussi faut-il tenir comme une sorte de privilège d’accéder enfin au versant Géorgien de sa filmographie, de la voir naître, pour ainsi dire, à sa source.
Si le premier, Avril – un film de fin d’études – appuie encore un peu fort sur la pédale de l’allégorie, dans une mise en scène dont le formalisme souligne les intentions, le ton est trouvé dès La chute des feuilles, qui voit un jeune homme, employé dans une cave coopérative, s’opposer à sa hiérarchie et refuser de valider la mise en bouteille d’un vin de mauvaise qualité sous prétexte de tenir les objectifs du plan. Ce pourrait être le portrait d’un parfait héros soviétique : ça ne l’est pas. Car Niko, gentiment cossard et vaguement je-m’en-foutiste, ne montre les dents que pour s’être un peu trop fait rouler dans la farine par une belle dont il est amoureux. En somme, le cave en a gros et se rebiffe avec une intransigeance qui relève bien plus du bras d’honneur que de l’éthique inoxydable de l’employé du mois. Ce maigre résumé, cependant, ne rend pas justice à un film dont la forme fait l’essentiel. Une forme éloignée de tous les canons hollywoodiens du scénario trop bien ficelé, efficace, et dont l’omniprésence finirait par nous faire croire qu’il n’y a qu’une seule façon de faire du cinéma. Celle de Iosselliani est avant tout musarde. Après un prologue joliment documentaire – ce pourrait être « les vendanges en Géorgie » – le film adopte un ton de promenade, tout en digressions et à-côtés gentiment farfelus, avec une insouciance qui ne laisse guère présager « l’héroïsme » final de Niko, dont, le naturel revenant au galop, on peut présager qu’il ne durera guère plus longtemps que « la chute des feuilles ».
Ce ton résolument badin, cet aspect funambulesque de la mise en scène, on les retrouve intacts dans les deux films suivants.
Il était une fois un merle chanteur fait le portrait d’un papillon. Musicien d’orchestre, Guia s’intéresse à tout, voit tout et jouit de tout avec un charme et une liberté dont la seule limite est d’arriver chaque soir à temps pour donner l’unique coup de timbale qu’exige de lui la partition. Insupportable ludion pour certains, irrésistible pour les autres, il n’est jamais là où on l’attend tout en parvenant à se glisser partout au fil ininterrompu des rencontres, des échanges et des rebonds. Cet écervelé n’est cependant pas sans profondeur. Curieux et attentif à toute chose, il n’a simplement pas le temps, comme si, d’instinct, il pressentait la fin prompte à venir – la sienne et celle d’un film dont, par conséquent, même la brièveté fait sens.
Pastorale, enfin, apparaît comme le couronnement et le point d’orgue de cette première période. Invité à passer l’été dans un village, un quintette de musiciens classiques confronte ses arpèges aux réalités paysannes le temps d’une saison. Quelle trace laisseront-ils ? Aucune, sans doute, si ce n’est dans l’âme de la jeune fille de la maison, à laquelle ces artistes, sans même le vouloir, auront offert une ouverture et une parenthèse dans sa morne vie de servante. Rien d’idyllique, en effet, dans la pastorale en question, sinon la note tenue d’une douce mélancolie sous la gaieté de la comédie villageoise et la satire sans acrimonie de la vie kolkhozienne, simples égratignures qui, certes, ne devaient pas suffire à motiver la censure de l’État. Bien moins, en tout cas, que cette secrète tristesse mêlée de résignation, cette façon de sourire au désespoir d’autant plus inquiétante pour le pouvoir qu’elle est insaisissable et, pour ainsi dire, consubstantielle au grain même de l’image.
Yann Fastier