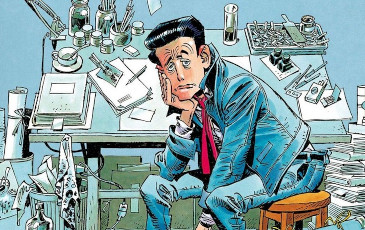Qui peut se vanter d’avoir lu un Mazenod de bout en bout ?
Avouons-le : ces pavés prestigieux semblent bien mieux faits pour décorer une table basse que pour être consultés, mieux destinés à servir d’arguments d’autorité en bibliothèque qu’à répandre l’amour de l’art dans les foyers. Trop beau, trop gros : ça sent toujours un peu la gonflette, le muscle en plastoc, la coquille vide et la rodomontade. Qui, après tout, prendra le temps de vérifier ? Eh bien, ce temps, on l’a pris, et on ne le regrette pas, s’agissant tout au moins de ce Chardin.
Bien sûr, il faut disposer d’une table assez large et solide. Un Mazenod, ça ne se lit pas au lit ou aux toilettes, ça ne se traîne partout dans un sac. Vu le prix, on hésite même à manger son sandwich au-dessus, sauf à cultiver le goût du risque. Mais ces obstacles une fois levés, une fois en tête-à-tête avec la chose dans le secret de son cabinet, loin des pattes sales du toutou et des velléités graphiques des enfants en bas âge, c’est un voyage merveilleux qui vous attend.
D’autant que Chardin n’est pas si facile à voir : à l’exception de ceux du Louvre, les plus beaux sont souvent à l’étranger, aux États-Unis ou en Allemagne. S’il a connu, comme d’autres, une courte période de désaffection, Jean-Siméon Chardin (1699-1779) ne fut jamais un peintre maudit. Célèbre de son vivant (Diderot était son plus grand fan), Chardin fut même une exception parmi les siens puisque peintre de natures mortes et de scène de genre, pas même portraitiste, il jouissait des mêmes prérogatives et privilèges que ses collègues adeptes du « grand genre », à savoir la peinture d’Histoire, réputée plus noble parce que plus exigeante, plus « cultivée » et, surtout, plus propre à célébrer les fastes de la Monarchie. Tombé en désuétude avec la Révolution qui préférait, à ses enfants rêveurs, les poses plus viriles d’un David, Chardin se fit oublier durant la première moitié du XIXe siècle (on pouvait alors en acheter pour dix francs !) avant d’être redécouvert et réévalué, entre autres par les frères Goncourt et Marcel Proust, selon une optique nouvelle qui, tout comme un Vermeer à la même époque, devait le rattacher à la modernité picturale pour en faire, ni plus ni moins, un précurseur de Cézanne et du cubisme. Si la liberté d’une touche privilégiant nettement la couleur à la précision du dessin, la solidité à toute épreuve de ses compositions et de ses éclairages le distinguent en effet de nombre de ses contemporains, Chardin n’en était pas moins de son temps, ce que rappelle Alexis Merle du Bourg, en spécialiste des peintres des XVIIe et XVIIIe siècles. D’une très belle écriture, sans lyrisme ni froideur – ces deux écueils habituels de l’histoire de l’art – il montre un Chardin tel que le connut son époque, loin de l’universalisme atemporel qui prévaut parfois à son sujet, mais aussi sans polémiques stériles, avec une pondération et une justesse de vue qui emporte d’emblée l’adhésion. À cet égard, jamais l’iconographie, aussi belle et soignée soit-elle, ne prend le pas sur le texte, qui reste maître du jeu de bout en bout : toujours pertinentes, même lorsqu’il s’agit de mettre en valeur un détail, les images ne viennent qu’en appui à ce qui constitue bel et bien l’épine dorsale de cette très exhaustive monographie. S’il laisse à d’autres le soin d’apporter de nouveaux éclairages (Pierre Rosenberg, notamment, mondialement reconnu comme étant le spécialiste de Chardin), le texte d’Alexis Merle du Bourg ne fait pas moins de cet ouvrage si luxueux qu’on l’avait craint de pur prestige le plus beau cadeau qui soit : non pas un beau livre, mais un bon livre.
Yann Fastier