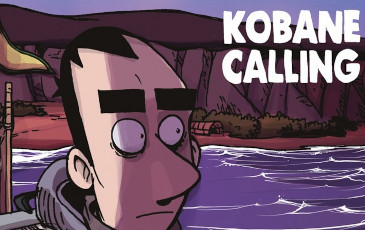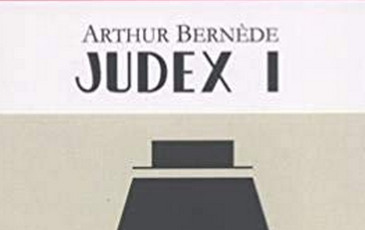Un homme perché au sommet du mât vertigineux, disproportionné, d’une minuscule barque de pêche ;
un autre escaladant à mains et pieds nus un gigantesque mât de cocagne lors d’une fête villageoise. Ainsi – entre défi prométhéen et fragilité humaine – s’ouvre et se ferme ce film exceptionnel, qui réunit les courts-métrages que le cinéaste Vittorio De Seta consacra aux cultures paysannes du sud de l’Italie dans les années 50. On entend déjà ricaner l’homo festivus, contempteur plus ou moins cérébré de la prise de tête et de la parlote. De la parlote, cependant, on n’en aura guère : le paysan sicilien est taiseux de nature et nulle voix off, nul commentaire pour ternir la beauté pure, presque suffocante, de ces images. Mais parler, après tout, ces gens n’en ont cure, qui accomplissent les mêmes gestes depuis des centaines d’années, peut-être des millénaires. Des gestes de travail avant tout, et dont l’intelligence crève les yeux, qu’il s’agisse de pêcher le thon ou l’espadon, d’extraire le soufre ou bien de moissonner, de façonner un fromage ou bien de cuire le pain. Chaque film est organisé de façon semblable : une journée, de l’aube à la nuit, une journée de travail où l’intelligence collective – que l’on n’a jamais si bien vue à l’œuvre – pallie des moyens souvent rudimentaires, un jour comme les autres, magnifié par la beauté caravagesque des clair-obscurs et des couleurs, par une science du montage et du rythme qui, bien au-delà du simple collectage ethnographique, transfigure le quotidien et le change en poésie pure. Bien sûr, ce sont les images d’une vie dure, qui ne disent rien ou presque de la pauvreté, de l’aliénation, de l’ignorance, parfois, du sexisme et de la violence, peut-être. Mais ce sont aussi les images d’un trésor culturel dont ces gens, la plupart du temps, ne se savaient même pas dépositaires et qui, par elles, leur est rendu.
Des dépositaires pourtant amenés à disparaître : car ces images sont aussi celles d’un monde perdu. Deux ou trois ans après le tournage, rien de tout cela n’existait plus. Ce que le Fascisme n’était pas parvenu à faire : extirper les cultures paysannes, exterminer les dialectes, la télévision devait l’accomplir en quelques années. Le tragique s’ajoute alors à la beauté et, à l’heure des bullshit jobs, où l’on parle tant et tant des métiers « essentiels », au regret d’un temps où le travail avait encore un sens. Peut-être était-ce inéluctable, peut-être est-il vain de pleurnicher sur un passé à l’authenticité douteuse, peut-être faudrait-il dresser la liste des avantages et des inconvénients de la modernité… Ce n’est pas le propos de ce film, le premier d’un réalisateur profondément humaniste (cf son Journal d’un maître d’école, récemment réédité et assorti d’une étude passionnante de Federico Rossin), archiviste d’un passé dont l’actualité, paradoxalement, ne s’est jamais tant fait sentir. Peut-être, alors, faudrait-il également s’interroger, sans qu’il soit bien sûr question de revenir en arrière, sur ce qui fait le sens d’une vie. Si elles ne répondent à aucune question, les images de ce film pourraient bien faire partie d’une réponse que l’on pressent depuis longtemps et que la crise actuelle, espérons-le, contribuera peut-être à formuler, enfin.
Yann Fastier