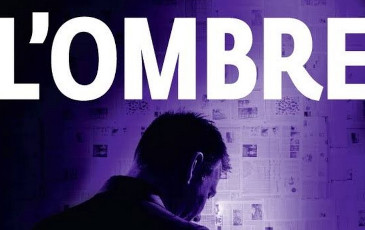Il y a Suisse et Suisse.
Celle des banques et des secrets bien gardés, la Suisse policée des grands sommets internationaux, celle de Davos, de Saint Moritz et des stations de ski, la Suisse industrielle et industrieuse, pharmaceutique, chimique et horlogère… Et puis il y a l’autre Suisse. Une Suisse rurale, enclavée dans ses vallées et ses particularismes, loin de l’opulence des capitales. Les Grisons forment le canton le plus oriental de la Confédération, l’un des plus grands aussi et celui dont la densité de population est la plus faible. C’est aussi, et surtout, le seul dont le romanche soit l’une des langues officielles. Langue rhéto-romane apparentée au frioulan et au ladin du nord de l’Italie, le romanche est le personnage principal de ces deux livres, dont la sortie conjointe ne manque pas d’à-propos. Mêmes lieux, même gens et, surtout, même langue, ils forment la chronique haute en couleurs d’une bourgade à la périphérie de toute modernité, aussi éloignée des clichés régionalistes que du chef-lieu de canton.
La parole est d’abord à l’enfance. Le très jeune narrateur de Derrière la gare voit tout, entend tout et le restitue avec toute la faconde naïve d’un petit Nicolas pas encore changé en marque. Faire parler les gamins est toujours un écueil pour un écrivain. Arno Camenisch s’en tire avec un naturel certain et sans en rajouter dans la fausse candeur. Entre écriture phonétique et formes romanches, il (et sa traductrice avec lui) improvise une langue qui, pour déroutante qu’elle puisse paraître au premier abord, n’en sonne pas moins au plus juste. Une langue haute comme trois pommes pour dire les petits et les grands événements du village, aussi mystérieux, parfois, pour le narrateur que pour le lecteur qui doit d’abord apprendre à la parler, cette langue tout en soubresauts : « Le premier avril, le Giacasepp dit va voir à l’épicerie et prends des marylongs et des tulihups, Fonsina en a besoin. Il me donne un billet de dix. Je dis à la Marionna de l’épicerie, des marylongs pil Giacasepp et des tulihups »… Le poisson, dans la bouche, vous en « nage entre les mots » et c’est un peu titubant – mais bien moins que les francs-buveurs qu’on y rejoint – que l’on aborde à l’Helvezia, l’unique auberge du village, pour une dernière soirée avant fermeture définitive. On retrouve dans Ustrinkata la quasi-totalité des personnages de Derrière la gare : la Tata, bien sûr, et l’Alexi, le Gion Bi, le Giacasepp et Luis da Schlans, le Gion Baretta, l’Otto, la Silvia… Les tournées défilent autant que l’ont fait les années : de chope en piccolo, de piccolo en café-goutte, schnaps et bière coulent à flot, tout comme la conversation, entre commérages et souvenirs. On entre, on sort, la familiarité s’installe et l’on est bientôt comme chez soi parmi ces rustauds pleins de délicatesse : « Ouais de temps en temps tu rapportes un cerf à la maison et tu le déposes sur la table de la cuisine, y a pas besoin de mots, dit le Luis, c’est bien assez d’amour. » Et tout est dit.
Yann Fastier