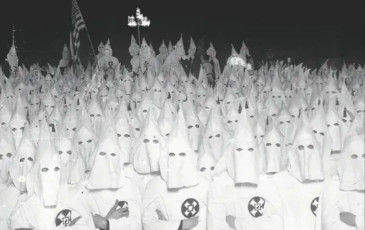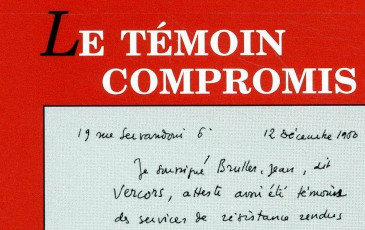A la fin du XIXème-début du XXème, outre-Atlantique et Outre-Manche, le journalisme d’immersion était en vogue.
Les quotidiens payaient rubis sur l’ongle des articles, très populaires, où des rédacteurs, célèbres ou non, racontaient comment on vivait dans la peau d’un autre, exotique, mystérieux, un ouvrier, un mineur, un interné psychiatrique… Jack London, George Orwell s’y collèrent pour ne nommer qu’eux.
C’est dans l’idée d’acquérir une notoriété dans ce domaine, notoriété qu’elle peine à gagner en Amérique, qu’Elizabeth L. Banks débarque à Londres en 1892, à vingt ans. Orpheline et néanmoins fortunée, elle déploie ses talents de mimétisme pour se glisser dans les chemises de demoiselles de basse extraction, lors de différentes enquêtes regroupées ici. Cherchant à rendre compte de la condition de la femme, des conditions de travail de celles qui, contrairement à notre American girl in London, ne vivent pas aux frais de la princesse et sont bien obligées de trouver de quoi assurer leur subsistance, elle devient tour à tour femme de ménage, balayeuse, bouquetière, autant de tâches dépaysantes qui seront de formidables terrains de jeux et d’étude pour l’impétueuse journaliste.
Ainsi, dans En bonnet et tablier, la première investigation du recueil, elle obtient, suite à une petite annonce, un emploi de domestique. Durant deux semaines consécutives, elle se fond dans le quotidien des servantes de deux bonnes maisons d’un quartier chic londonien. L’immersion donne lieu à des situations cocasses autant que pathétiques. Cocasses car Elizabeth ne connaît rien aux tâches domestiques, ne sait pas distinguer un torchon d’une serviette et apprend dans les livres, n’hésitant pas à mettre les mains dans la lessiveuse et user d’huile de coude. Pathétiques car le travail n’a rien d’une sinécure. Les seaux d’eau sont lourds, les salaires légers. Il ne faudra pas attendre d’elle la moindre solidarité de classe, évidemment, et elle dénonce autant la pingrerie de patrons peu soucieux du bien-être de leurs employées que la bêtise, la fainéantise et la malhonnêteté de ses éphémères collègues.
Ses articles, publiés dans The Weekly Sun, connaîtront un franc succès. La jeune femme s’y montre volontiers donneuse de leçons, juge des aptitudes de ses consoeurs, oubliant souvent qu’elle ne risque pas de s’être usée la couenne au bout d’une semaine, contrairement à ses camarades, elles, d’infortune. Néanmoins, sa belle plume et l’humour dont elle s’avère capable aussi envers elle-même la sauvent d’être tout à fait insupportable et font de ses récits un témoignage passionnant des mœurs dans la capitale anglaise à l’ère victorienne.
Marianne Peyronnet