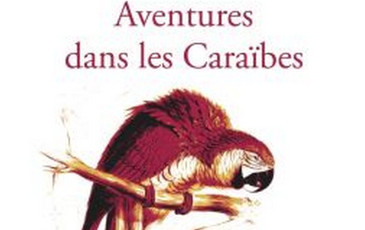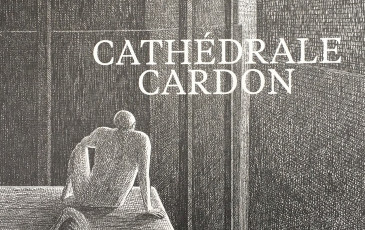Deux pertinentes rééditions font ressortir de l’ombre l’un des plus beaux romans d’amour contemporain et son auteure, figure d’un engagement sans faille, tout de courage et d’intégrité.
Oubliez Zweig et Kasparov, le jeu dont il est question dans ce roman ne se joue pas en noir et blanc sur de petites cases. C’est d’amour qu’il s’agit, et si l’amour peut être un jeu, il est ici perdu d’avance. Aude, la narratrice et le double transparent de l’auteure, écrit une lettre à Stevan, l’amant d’un soir, disparu depuis sans explication. Cette lettre, elle ne l’enverra pas, elle l’écrit pour elle-même, sans jugement ni complaisance et pour solde de tout compte.
Comment ne pas soupçonner dans ce livre paru en 1970 – quelques mois avant la mort d’Edith Thomas – une manière de bilan de sa propre vie amoureuse ? Une vie sans cesse poussée vers la plus grande solitude par les échecs successifs dont le récit, déchirant de dignité, se fait l’écho parfois presque ironique : « C’est comme si chacun n’avait jamais à sa disposition qu’un même patron, taillé une fois pour toutes, le jour de sa naissance, par quelque bonne ou mauvaise fée. La mienne sûrement était assez carabosse » constate-elle sans amertume avant d’évoquer celle qu’elle aima sûrement le mieux, cette Claude qui fut en réalité Dominique Aury (la mystérieuse Pauline Réage d’Histoire d’O) et qui la quitta pour Jean Paulhan. Certes, tout est ici transposé dans la fiction, mais de telles catégories signifient-elles quelque chose dans le cas d’Edith Thomas qui, toute son existence en porte témoignage, ne fut jamais femme à cultiver les faux-semblants. Tout est donc vrai, même ce qu’elle invente et jusqu’à cet enfant qu’elle n’eut jamais qu’en rêve et sans cesser de se demander si l’on a le droit « (…) d’imposer de tenter sa chance à un être qui n’existe pas encore ? »
Cette honnêteté foncière qui se mue facilement en scrupule, jointe au mépris souverain des convenances, peut-être est-ce au fond ce qui la retint toute sa vie de l’autre côté de l’amour et la rend dans ce livre à la fois si lucide et si juste, à un point dont seul le Commentaire de Marcelle Sauvageot avait jusqu’alors su donner l’exemple. Ainsi parvient-elle à nous toucher au cœur sans jamais faire appel aux violons, par la seule force de sa sincérité et de sa discrétion, revendiquée dans un très bel explicit adressé à sa fille virtuelle : « Quant à moi, je reviendrais sans cesse à toi, Anne, jusqu’au jour où tu n’aurais plus besoin de moi, et courrais seule à ton tour ta propre chance, et me rendrais pour jamais à ma solitude et à mon silence. »
Cette discrétion ne fut sans doute pas pour rien dont l’oubli relatif où Edith Thomas tomba après sa mort. A l’écart des coteries littéraires, elle avait depuis longtemps cessé d’écrire des romans pour se consacrer à des biographies historiques auxquelles la prédisposait son métier d’archiviste. Aussi les éditions Viviane Hamy ont-elles eu la bonne idée d’assortir cette réédition du Jeu d’échecs d’une reparution en poche du Témoin compromis, son autobiographie politique, écrite en 1952, peu de temps après sa démission fracassante du Parti Communiste. Edith Thomas était alors une figure assez connue du public : romancière et journaliste dans les années 30, elle avait couvert la Guerre d’Espagne aux côtés des Républicains avant de s’engager dans la Résistance, où elle fut notamment l’une des chevilles ouvrières des Lettres Françaises et du Comité National des Ecrivains. D’abord simple sympathisante, elle avait pris sa carte au Parti en 1942, en pleine Occupation, pour en démissionner au moment de l’affaire Tito. Une femme aussi passionnée d’éthique ne pouvait évidemment s’accommoder bien longtemps d’une Eglise où le mensonge était érigé en système et la bassesse en doctrine. Ce fut un déchirement, et sans doute ce qui la poussa à rentrer dans l’ombre quand tant d’autres, Sartre et Beauvoir en tête, tiraient alors les marrons d’un feu auquel ils n’avaient guère risqué de se brûler.
Yann Fastier