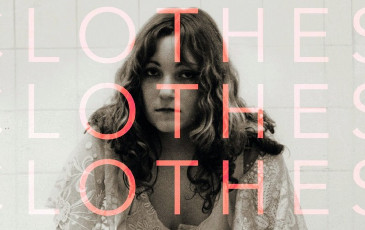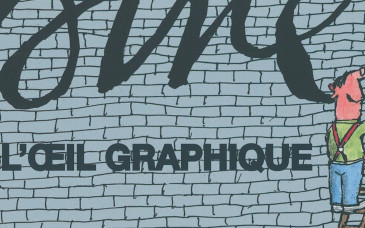Bonne idée que cette réédition de l’autobiographie de Jack Black, parue pour la première fois aux Etats-Unis en 1926, excellent témoignage de première main sur l’Amérique au début du 20e siècle, côté bas fonds.
Rien ne prédisposait Mr Black à devenir voleur puis écrivain. Jack est très tôt privé de mère, et son père, honnête homme rigoriste, l’envoie faire son éducation dans un pensionnat de bonnes sœurs qu’il quitte à quatorze ans. Il s’y découvre une passion pour la lecture des « classiques » (Hugo, Dickens, Dumas !…) et des journaux, où l’on relate dans le détail les faits d’armes de Jesse James, son héros. Est-ce là que se forge en lui une envie de s’évader si profonde qu’il refusera, presque toute sa vie, de rentrer dans le rang d’une existence trop étriquée, lui préférant les grands espaces, et une certaine idée de la liberté qui le conduira à sa condamnation à vingt-cinq ans de pénitencier ? Ou est-ce cet épisode où il se retrouve accusé à tort qui le fait basculer dans le banditisme et les marges ? Il faut reconnaître que la répression qui s’abat sur les gens de peu de bien est à l’époque si cruelle et si peu subtile que l’on ne saurait lui donner tort quand il affirme : « L’idée de travailler m’était aussi étrangère que celle de cambrioler une maison le serait à un plombier ou à un imprimeur. Je n’étais pas paresseux ou tire-au-flanc ; je savais qu’il y avait des moyens moins risqués et compliqués de gagner sa vie, mais c’était la façon de faire des autres (…) Je ne les traitais pas de gogos ou de péquenauds sous prétexte qu’ils étaient différents et travaillaient pour vivre. Ils représentaient la société. La société représentait la loi, l’ordre, la discipline, le châtiment. La société, c’était une machine conçue pour me mettre en pièces. La société, c’était l’ennemie. » Il lui préfèrera donc le destin de hors-la-loi, toujours en cavale, traversant les USA en trains de marchandise, caché parmi les hobos et trouvera ses amis chez les Johnson, ces traîne-savates au grand cœur et à la fidélité indéfectible. Devenu Yegg, perceur de coffres, ses fortunes sont diverses mais le lecteur se régale de sa description précise des coups montés, dans ce monde disparu des saloons, des femmes de petite vertu, des chinois à nattes dans le dos et des fumeries d’opium. Les scènes d’anthologie se succèdent sous la plume fleurie de Jack Black. Calculer la bonne dose de dynamite pour faire sauter la banque ou se mouvoir tel un fantôme dans la chambre de ce gros type endormi sur son paquet d’oseille… le lecteur tremble de voir Jack se faire attraper. Les empreintes digitales n’avaient pas encore révélé leurs secrets, et les systèmes de sécurité étaient peu efficaces, il se fera pourtant coffrer à de nombreuses reprises et subira les foudres d’une justice expéditive : coups de fouet, cachot, privation de nourriture et d’eau, camisole de force… Son récit des conditions d’incarcération est terrible et remarquable de lucidité. Sauvé par l’empathie de certains hommes, il finira par mettre un terme à des années d’errance et de solitude et se consacrera à la dénonciation des mécanismes sociaux qui poussent l’individu à la délinquance. Ses mots (1929) sont toujours tristement d’actualité : « Multiplier les lois et durcir les peines ne peut conduire qu’à davantage de crimes et de violence… Les honnêtes gens prennent le problème à l’envers. S’ils s’intéressaient plus à l’éducation des enfants, ils se désintéresseraient vite de la chaise électrique. Ils ne voient que les crimes et jamais les raisons qui poussent les criminels à agir ; ils ne voient que ce qu’ils sont devenus et jamais ce qui a fait d’eux ce qu’ils sont. »
Marianne Peyronnet