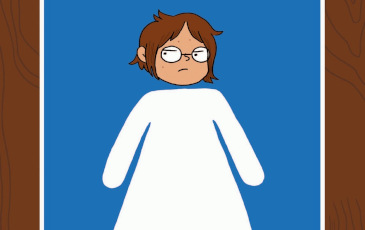L’art de Gilles Aillaud (1928-2005) est indissolublement lié à l’apparition, dans les années 60, de ce que le critique Gérald Gassiot-Talabot a appelé la Figuration narrative,
en réaction aux tentations formalistes de l’abstraction (Support Surface, BMTP…) et à l’hégémonie duchampienne du Pop Art, représentée en France par le Nouveau Réalisme (Klein, Arman, Spoerri et alii). Issue des débats et des réflexions autour du Réalisme socialiste – ou de la version française qu’en donnèrent des peintres comme André Fougeron, Jean Hélion ou même Bernard Buffet à ses débuts – elle proclame l’avènement d’une peinture essentiellement politique, discursive et débarrassée des questions de style, jugées bourgeoises. Aux côtés d’Aillaud, ses principaux représentants (Eduardo Arroyo, Gérard Fromanger, Antonio Recalcati, Henri Cueco et la Coopérative des Malassis, Jacques Monory...) seront les trublions infatigables d’une peinture plus militante qu’« artiste », travaillant souvent d’après photo, dans un esprit où le collectif et l’engagement prennent largement le pas sur l’individu dans le grand chaudron idéologique de l’époque. Une fois terminée la guerre du Vietnam et passée la gueule de bois de l’après-68, que devait-il cependant rester de tout ça, sinon les vestiges un peu ternes d’une époque trop bavarde ? Le nom de Gilles Aillaud, quant à lui, demeure associé à ses représentations d’animaux en cage, auxquelles le catalogue de cette rétrospective au Centre Pompidou fait évidemment la part belle : lions, léopards, orangs outangs, rhinocéros, éléphants… le vivant selon Aillaud est avant tout tenu à distance, enfermé, cerné par l’appareillage complexe des barreaux, des fosses et des barrières. Réduit à quelques taches, parfois, il se fond dans un décor de lignes dont la perfection glacée confine à l’abstraction, aussi bien pris dans le tableau lui-même que dans la réalité dystopique de sa condition captive. Le sens politique d’une telle peinture saute aux yeux : l’aliénation des animaux de zoo est la nôtre, dont le bestiaire de Gilles Aillaud, artiste engagé s’il en est, forme la métaphore transparente. Comme toutes les évidences, cette lecture trop simple dissimule peut-être une autre vérité, plus intime, plus personnelle. Agacé par la question sempiternelle de la critique : « Pourquoi les animaux ? », Gilles Aillaud répondit un jour : « Parce que je les aime ». Tout simplement. Et le discours trop lisse de se fissurer pour laisser poindre une compassion bien plus authentique et, surtout, un plaisir de peindre qu’on avait cru anachronique. Formé à l’ancienne, Aillaud aimait donc jouer avec les formes et les couleurs ? La dernière partie de son œuvre le prouve à l’envi. Réalisée en Afrique, dans les réserves où les animaux peuvent encore se donner plus ou moins libre cours, et soutenue par les beaux textes de Jean-Christophe Bailly, elle tend vers l’encyclopédisme, cet embrassement de la réalité du monde dont, enfant, il rêvait déjà. Le peintre se libérant en même temps que son sujet, son trait, sa touche s’aèrent, se font plus libres, ouvertes, fluides et légères, une fois gommés les barreaux. L’animal se fond alors littéralement dans le décor qui devient paysage et non plus quadrillage. Un paysage où le peintre, et avec lui le regardeur, s’abîment enfin dans la beauté réconciliée du monde.
Yann Fastier