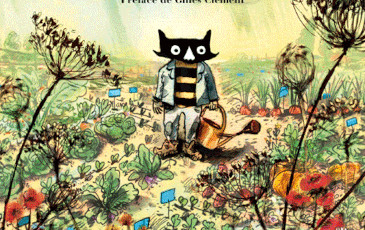Il peut y avoir une forme d’inconvenance ou de naïveté à prétendre introduire un classique et, pourtant, les statistiques sont là :
qui lit encore Augusto Roa Bastos (1917-2005) dont Moi, le Suprême, publié en 1974, devait rejoindre instantanément le firmament des chefs d’œuvre du « réalisme magique » sud-américain, aux côtés de Cent ans de solitude, du Colombien Gabriel García Márquez ou des Hommes de maïs, du Guatémaltèque Miguel Ángel Asturias ? Aussi n’estimera-t-on pas superflu de faire un court rappel.
Bien qu’unifiée par la langue (hors Brésil et confettis), l’Amérique Latine n’en est pas moins diverse dans son histoire et ses cultures. Parmi les pays qui la composent, le Paraguay est l’un des moins connus. Enclavé, sans accès à la mer, il fut pourtant le premier à accéder à une indépendance complète, en 1811, avant de devenir l’un des plus avancés, socialement et économiquement, sous l’impulsion d’une série de despotes éclairés dont le plus étonnant reste le premier, José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840). Le Suprême, c’est lui. Fervent admirateur des Lumières et de la Révolution française, élu par le Congrès « Dictateur Suprême et Perpétuel du Paraguay », il devait diriger le pays d’une main de fer jusqu’à sa mort, engageant des réformes qui en marqueront durablement la singularité, du moins jusqu’à la catastrophe des guerres de la Triple-Alliance (1864-1870) qui laisseront le Paraguay exsangue, amputé d’une grande partie de son territoire et de 60 % de sa population !
Que se passe-t-il dans la tête d’un homme qui, si impitoyable fut-il envers ses ennemis réels ou supposés, n’en permit pas moins à la majeure partie de la population de vivre honorablement de son travail et généralisa si bien l’instruction élémentaire que tout le monde ou presque sut bientôt lire et écrire dans un Paraguay pacifié, exempt des guerres incessantes menées par les cruels et éphémères caudillos des pays voisins ? Que se passe-t-il dans la tête d’un homme qui, champion fanatique de l’indépendance nationale, fit de son pays une sorte de forteresse coupée du reste du monde, au point d’assigner à résidence, parfois pour des années, tout étranger ayant pénétré sur son sol ? Que se passe-t-il dans la tête d’un dictateur aux méthodes certes expéditives mais qui, lui-même d’une honnêteté scrupuleuse, fit de l’oligarchie sa bête noire, décapita l’Église et se méfiait des militaires au point de supprimer tous les grades au-dessus de capitaine ?
Écrire l’histoire du Paraguay du seul point de vue de celui-là même qui en fut l’un des principaux acteurs, tel était donc l’objectif que s’assignait Augusto Roa Bastos avec ce roman qui ne cède rien – mais alors vraiment rien ! – au réalisme plus ou moins documenté des exo-fictions à la mode. Sans la moindre description, sans personnages, sans pittoresque ni « couleur locale », l’auteur paraguayen, alors réfugié en France, laissait libre cours à la parole du dictateur mourant. Parole délirante, entremêlée, bouillonnante et jouant tous les rôles à la fois, toutes les « voix » pourrait-on dire, tous les registres, des plus soutenus aux plus orduriers, bousculant les chronologies, mêlant culture savante et culture populaire, légendes et jeux de mots, au gré d’une langue s’autorisant tous les glissements, tous les déferlements, d’une langue invasive, proliférante à l’infini, presque fractale à force de commenter ses propres commentaires, métissant les sources réelles ou inventées, et ringardisant d’un coup toute idée de biographie ! Jamais roman ne fut aussi littéralement « fleuve », avec ses limons et ses tourbes, ses tourbillons et ses remous, ses rapides et ses bras morts, et la navigation, certes, en est parfois coriace – il faut s’accrocher – mais, avant que de se replonger dans l’eau tiède des rentrées littéraires, il n’est pas interdit de se prendre une bonne rincée, quitte à faire des comparaisons risquées pour nos malheureux goncourables et préférer pour longtemps le curare aux pastilles Vichy.
Yann Fastier