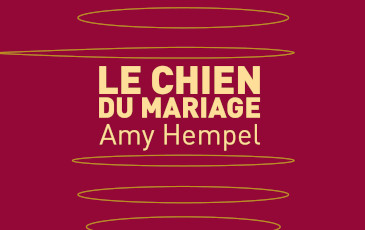On aura beau croire avoir déjà tout lu sur le sujet, on aura beau n’entretenir aucun doute, on aura beau savoir, les nazis ne cesseront jamais de nous surprendre.
Non pas de nous étonner, mais de nous surprendre, tel qu’on peut l’être au passage d’un train ou soudain pris dans la lueur des phares. Sidéré. Comment une telle dégueulasserie fut-elle possible ? Comment l’est-elle ? Car le propre du nazi – et peut-être sa punition – c’est de hanter un éternel présent, de n’être jamais passé, de faire l’objet d’une mémoire sans cesse réitérée, entre autres par la littérature. Et les traits de l’Ennemi de se tordre en pleine lumière sous l’énumération jamais achevée de ses crimes.
Paru en 1960, après une maturation de plus de dix ans, Mendelssohn est sur le toit n’emprunte pas pour les dénoncer les accents grandiloquents que l’on reprocha parfois à la littérature de la Résistance. Il préfère un certain ton de bonhommie, teinté de cet humour aimablement satirique qui semble n’appartenir qu’aux Tchèques, comme une affirmation de la vie face à la mort qui, ces années-là, pactisait franchement avec l’ennemi : « La mort était le fief des envahisseurs. Ils la célébraient dans leurs chants et leurs marches. Elle était leur meilleure amie ». Une bonhommie qui ne signe cependant aucune légèreté face à l’iniquité. Tout est dit, tel qu’il fut : la déportation massive des Juifs de Bohême-Moravie (plus de 70 000 y laisseront la vie), la sanglante mascarade du « ghetto modèle » de Theresienstadt, les exécutions, l’arbitraire érigé en règle, les humiliations constantes et jusqu’au meurtre abject de deux petites filles juives. Mais les héros de Jiří Weil sont avant tout ceux du quotidien, des Tchèques ordinaires, juifs et non-juifs, tous unis, cependant, par une même détestation tranquille des envahisseurs « avec leurs tambours, leurs fifres et leurs queues de cheval », gueulards, avides, voleurs et mesquins, loin, bien loin de l’imagerie marmoréenne véhiculée par leur propagande.
C’était sans doute le meilleur traitement à leur réserver : les montrer sous leur vrai jour. À cet égard, l’épisode qui ouvre le roman donne le ton. Heydrich, grand « protecteur » de Bohême, mélomane et n’ayant pas encore reçu la grenade qui l’attend au coin d’une rue de Prague, a ordonné le déboulonnement d’une statue de Mendelssohn sur le toit de l’ancien Parlement. Chargé de la mission, Schlesinger, un SS quelconque, y perd son gothique : laquelle de ces statues est celle du compositeur juif ? Facile ! C’est forcément celle qui a le plus gros nez. Mètre à l’appui, il s’avère que c’est celle de Wagner. Que faire ? De petit chef en petit chef, l’affaire remonte assez loin pour que l’on fasse chercher un « Juif savant » parmi ceux qui n’ont pas encore été déportés. Ce sera le Dr Rabinovič, talmudiste réputé, pour qui « les statues ne pouvaient que lui porter malheur, c’était de l’idolâtrie ». Ainsi tous les personnages du roman se croisent-ils à un moment ou un autre. On les suit, puis on les perd pour les retrouver un peu plus loin tandis que la tragédie s’achemine vers sa fin. Car, derrière la bouffonerie, la mort est toujours là, qui « se collait aux talons de sa victime et la terrorisait de ses clameurs ». Ce qu’il conte, Jiří Weil en a été le témoin direct : né en 1900, ayant échappé par miracle à la déportation, il a lui-même travaillé au Musée juif dont son Dr Rabinovič est l’éphémère conservateur. Il continua après la guerre, alors qu’il était plus ou moins interdit de publication par les communistes au pouvoir. C’est à ce titre qu’il rédigea la terrible Complainte pour 77 297 victimes qui accompagne le livre en introduction, dont l’horreur n’égale que la dignité. Celle-là même, sans faille, que l’on retrouve derrière l’apparent détachement de Mandelssohn est sur le toit, comme un sourire embellit un adieu.
Yann Fastier