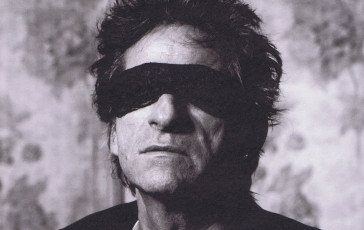Hickum Looney arpente les rues de Miami depuis un quart de siècle au service de la société Des savons pour la vie.
En 25 ans de porte à porte, il excelle dans son domaine. Il est presque aussi bon vendeur que Le Chef, fondateur de la boîte. Il s’en fout, des savons, il n’a même jamais eu la curiosité de les essayer. Il trimballe sa mallette remplie de fausses savonnettes en cire, applique les préceptes du Manuel de vente, et ça marche. Ça marche tellement bien, qu’un jour il arrive à dépasser le record détenu par le Grand patron. Qui se vexe. Les ennuis commencent.
Quel surprenant roman dans la bibliographie de Harry Crews ! Qu’on est loin de La foire aux serpents ou du Chanteur de gospel ! Parce que si on pleure bien ici aussi, c’est de rire. Le style, d’abord, fait la part belle à des reparties cinglantes, des répliques qui tuent, rares chez l’auteur du Faucon va mourir. Hickum est plutôt posé, bon élève, ça ne l’empêche pas de se défendre, avec de nombreuses chambrées de la sorte : « Seigneur Dieu, t’es fabriqué comme un oignon, toi. À chaque fois qu’on enlève une couche, y en a une encore plus pourrie en dessous. »
Ensuite, si l’on retrouve certains des thèmes récurrents chez Crews, les procédés employés sont très éloignés du roman noir, et concourent à la farce. L’étrange, le fantastique, par exemple, y font comme toujours leur apparition, dans une réalité prosaïque, sous les traits de personnages difformes, freaks, phénomènes de cirque, êtres différents rejetés par la norme. Ces personnages déclenchent d’ordinaire dans son œuvre d’intenses sentiments d’empathie. Le Grand patron Des savons pour la vie est, à ce titre, très crewsien, puisque nain, affublé qui plus est, d’un bec de lièvre. Sauf que là, le portrait se fait caricature, et fait hurler de rire. Le Chef est tyrannique, prétentieux, il a tous les pouvoirs et l’humiliation est son passe-temps favori, ainsi que les dérouillées qu’il administre à ses sous-fifres, craignant trop de perdre leur boulot pour se révolter. Si son défaut d’élocution les fait pouffer, et le lecteur avec, (« Mon nec-ne-lièvre, n’est Nieu qui ne l’a nonné ! »), c’est par derrière. Par devant, ils auraient plus tendance à chier dans leur froc, au sens propre. A ce titre, la scène au cours de laquelle Hickum rencontre Gaye Nell, celle qui va bouleverser sa vie, est irrésistible. Comique de situation (Hickum le coincé, le bon élève se retrouve cul nu, avec des coulées marronnasses le long des cuisses face à une jeune femme brute de décoffrage que rien ne choque), et dialogues savoureux (A Hickum qui se plaint des mœurs légères des femmes : « De nos jours, elles sont presque nues de toute façon, vu comme elles s’habillent (…) Y a même des fois où elles mettent carrément rien, pas même une culotte (…) Les femmes prennent trop à la légère la hauteur de l’ourlet. » Gaye Nell rétorque : « Je vais être gentille, je vais te dire un truc gratos. Y a deux choses au monde qu’une femme – n’importe quelle femme – sait toujours exactement où ça se trouve : son ourlet et son sac à main. ») font progresser le récit, rythmé de grands coups de tartes dans la gueule.
Le tout finira dans une apothéose absurde, surréaliste
Alors, bien sûr, on retrouve dans Des savons pour la vie une critique acerbe du capitalisme sauvage, incarné ici par des techniques de vente d’un cynisme absolu (C’était quasi injouable de vendre quoi que ce soit à une personne heureuse. En revanche, dès qu’il sentait des failles sérieuses, la maladie, ou toute expérience ayant frôlé la mort, c’était une autre paire de manches. Le chagrin vous faisait acheter n’importe quoi à n’importe quel prix, quelle qu’en soit l’absurdité (…) Hickum avait toujours pensé qu’un homme meurtri dans son corps et dans son esprit était le pigeon idéal, et plus il était brisé, plus la vente se révélait facile.) La société de consommation est moquée, au moins autant que dans Car, où le public se pressait pour voir un homme manger une voiture, symbole de la grandeur américaine, petit bout par petit bout. Mais la remise en cause d’une certaine américaine prend ici les fards de la comédie burlesque, et penche plus du côté de Westlake, avec un univers peuplé de seconds couteaux, bras cassés hauts en couleurs, tous plus débiles les uns que les autres, que de Goodis. Etonnant.
Marianne Peyronnet