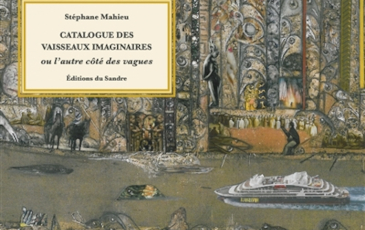Compilation de lettres, pour la plupart adressées à ses éditeurs, rédigées entre 1945 et 1993,
Sur l’écriture, plus qu’un recueil de conseils avisés sur la façon de bâtir une œuvre littéraire, dessine en creux un portrait du Vieux Dégueulasse, de ses obsessions et aspirations. Bukowski prend la plume et déballe ce qu’il a sur le cœur, sans fioriture, sans formule de politesse. Il aboie, il gueule, il vomit sa haine d’une modernité fade :
« Des tas de choses ne sont plus ce qu’elles étaient, le courage, le culot, la clarté – et le sens artistique. (…) Tout est parti en couilles avec la seconde guerre mondiale. Et ça ne s’applique pas qu’au monde des arts. Même les cigarettes n’ont plus le même goût. Le tamal. Le chili. Le café. Tout est en plastique. Les radis ne paraissent plus aussi âpres. (…) Les côtelettes de porc sont toutes roses et grasses. Les gens se contentent d’acheter de nouvelles voitures et c’est tout. Leur vie se résume à quatre roues. (…) Quiconque ayant bu un verre est considéré comme un alcoolique. Les chiens doivent être tenus en laisse. Les chiens doivent être vaccinés. (…) Les bandes dessinées sont considérées nocives pour les gamins. Et en littérature, il n’y a rien : aucune vie. »
Il lui en faudrait peu pour s’attendrir pourtant, s’apaiser ; la simple promesse qu’on lui foutra la paix, demain et tous les jours suivants, et qu’il pourra écrire. Il va bien tant que le berce le son de sa machine à écrire et que l’étourdissent quelques bouteilles de bière, à portée de clavier. Qu’on le laisse tranquille, Hank, il ne déteste rien de plus que ses semblables imbus d’eux-mêmes, pisse-vinaigre, fats, scribouilleurs sans noblesse, et il l’éructe, dans une langue abrupte dressant la grossièreté au rang d’art de vivre :
« J’ai toujours été un solitaire. Je vais être franc ; je n’aime pas la plupart des gens – ils me fatiguent, me pompent l’air, me sortent par les yeux, me détroussent, me mentent, me baisent, me trompent, me donnent des leçons, m’insultent, m’adorent ; mais surtout ils parlent parlent PARLENT jusqu’à ce que je me sente comme un chat fourré par un éléphant. »
Sa solitude le ravit. Non pas qu’il se sente supérieur, mais le monde lui fait mal, ce monde terne, sans panache, rabougri, rempli de mesquins et de poltrons incapables de saisir la beauté des choses. La beauté, lui la voit dans les jambes des femmes, sur les champs de course, dans les symphonies à la radio, dans Céline, Dostoïevski, John Fante, Sherwood Anderson… Bukowski a le goût très sûr, la pugnacité sans faille, l’humour cinglant, les aversions tenaces :
« Et puis ces gens qui me disent, « pourquoi vous buvez? C’est destructeur. » Et comment, que c’est destructeur (…) Ils croient que je m’en fous, ils croient que je ne ressens rien sous prétexte que mon visage est flétri et que les yeux me sortent de la tête tandis que je parcours le journal hippique une bouteille à la main. Ils ressentent les choses de façon si CHARMANTE, les enculés, les connards, les suceurs de citron de merde aux sourires visqueux, ils ressentent COMME IL FAUT, bien sûr, seulement ça n’existe pas les bonnes façons de ressentir, et ils finiront par s’en rendre compte (…) Ils peuvent prendre leur lierre, leurs éléments métriques et se les mettre dans le cul… s’il n’y a pas déjà quelque chose fourré là au fond. »
Pas de conseils sur comment écrire donc, mais une certaine idée de la littérature, flamboyante, bouleversante, absolue. La littérature comme horizon, sublimée par un kamikaze des mots, un épicurien qui n’a pas dévié d’un millimètre de sa route, même s’il l’a parcourue en titubant :
« Ma conception de l’écrivain c’est quelqu’un qui écrit. Qui s’assoit devant sa machine à écrire et noircit du papier. Ça devrait être la base. Ne pas dire aux autres comment s’y prendre, ne pas garnir les rangs des séminaires, ne pas lire devant des foules déchaînées (…) Autrement, la dernière personne avec qui j’ai envie de boire un coup ou tailler une bavette est un écrivain. J’ai trouvé plus de fougue chez les vieux marchands de journaux, les concierges, chez le gamin qui bosse la nuit sur le stand de tacos. Il me semble que l’écriture fait ressortir le pire, non le meilleur, il me semble que les presses à imprimer du monde entier ne font que presser la pulpe d’âmes insuffisantes que des critiques insuffisantes appellent littérature, poésie, prose. (…) C’est l’humanité tout entière qui me dégoûte et plus particulièrement l’écrivain créatif. (…) En revanche, j’ai toujours eu de l’affection pour les Chinois. Je suppose que c’est parce que la plupart d’entre eux sont si loin. »
Marianne Peyronnet